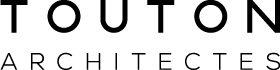Hugues Touton | Esthétique de l’usage
Je profite de la voie ouverte par Stéphane Hirschberger qui évoquait ici même le mois passé, la place nouvelle de l’architecte devenu médiateur dans une société de plus en plus concernée par la qualité environnementale. L’accent était mis dans cet article sur la dimension sociale du Développement Durable et suggérait la nécessité d’un retour nécessaire à l’idée de participation des citoyens à la conception, du partage de l’architecture avec les usagers.
Tout en souscrivant à cet impératif, je développerai ici l’idée de la mise en œuvre des « renoncements inéluctables » qu’évoquait notre confrère et auxquels l’architecture se doit de participer, j’y chercherai également quelques pistes de compensations.
Un avenir incertain
La question environnementale est maintenant au cœur de notre société : la structure techno-administrative s’est emparée du thème, les experts, les contrôleurs prolifèrent et le charme naïf de croire pouvoir sauver le monde cède petit à petit la place à la lourdeur règlementaire subie, à l’application aveugle des normes par des techniciens très spécialisés et très compétents dans des domaines minuscules. La cohérence du tout, le sens, s’effondrent dans le fragment au moment où l’horizon se bouche ; la Crise, là de suite, mais les pénuries ensuite et l’inévitable rétrécissement de l’espace qui en découlera, de l’espace public – le drame de la rurbanisation n’est déjà plus seulement esthétique – et de l’espace privé ; on sourit aujourd’hui avec nostalgie au slogan de la fin des années 80 : « Le luxe c’est l’espace ».
De moins en moins d’espace et probablement de moins en moins d’objets : « Il se peut que, par des voies encore très difficiles à cerner, l’Europe donne un jour naissance à une révolution contre-industrielle, de même qu’elle a engendré la révolution industrielle. Certains idéaux (…) quasiment étouffés dans la consommation et les uniformités des modèles américains et américano-asiatiques, peuvent garder leur fonction naturelle dans un contexte européen, même si ce contexte a pour conséquence un certain degré de décroissance matérielle. »[i] Nombreux sont ceux qui doutent aujourd’hui de la possibilité même d’un Développement Durable et les penseurs qui, dès les années cinquante, ont initié la remise en cause des bienfaits de la croissance, de la technique, du progrès – Ellul, Jouvenel, Dumont, Illich et d’autres – sont de plus en plus réédités et relus.
Décroissance de la production et de la consommation d’objets inutiles… Notre imaginaire est tellement colonisé par l’idée de croissance infinie qu’il nous est pourtant impossible de souhaiter froidement cette décroissance nécessaire et sa traîne de drames sociaux ; on ne fait pas faire marche arrière instantanément à un train lancé de toute sa puissance sans dégâts considérables[ii].
Et il ne s’agit pas ici de promouvoir l’être sur l’avoir, suivant en cela notre culture religieuse et philosophique millénaire comme le rappelle Bruce Bégout pour Arc-En Rêve[iii] car « à la différence du caractère immatériel de l’Etre, l’Avoir donne aux hommes une objectivité tangible et durable, et favorise par là-même leur existence mondaine en leur conférant des repères stables sur lesquels ils peuvent s’appuyer. » Bruce Bégout dans cet article retrouve l’étymologie de l’habiter dans l’avoir latin (habere) ; nous existons – notre être se retrouve plus facilement – à travers nos objets familiers, ce que nous avons. Trop d’objets mais les objets sont donc indispensables ; tout est question de mesure et l’architecte, celui qui selon Philippe Boudon donne des mesures à l’espace, doit devenir celui qui apporte de la mesure à l’espace, qui ménage.
Une lassitude des images, une critique de la forme
Les architectes sont quant à eux de grands consommateurs d’images. L’originalité est un de leurs moyens de vivre. Elle peut en devenir un but. L’accélération de cette consommation de formes détachées des usages – qui en sont pourtant la raison d’être – n’est pas sans rapport avec la frénésie contemporaine pour des objets peu utiles et dont le rythme de péremption s’emballe.
Viollet-le-Duc constatait déjà dans ses Entretiens que « les arts se développent activement lorsqu’ils sont pour ainsi dire, rivés aux mœurs d’un peuple, qu’ils en sont le langage sincère ; ils déclinent lorsqu’ils s’écartent des mœurs pour former comme un Etat à part, qu’ils deviennent une sorte de culture particulière ; alors peu à peu on les voit se refermer dans les écoles, s’isoler ; ils adoptent bientôt un langage qui n’est plus celui de la foule »[iv].
Cependant, atomisé dans l’individualisme de la société contemporaine, le goût collectif – constitutif des mœurs d’un peuple – n’existera plus jamais et seule l’hostilité des associations à l’égard de certains projets en maintient l’illusion : tous contre un, plus jamais « tous pour un ».
S’attaquant plus récemment à l’ego des architectes dans un article sur le Pritzker Price 2006 de Paul Mendes da Rocha, Richard Scoffier fait ce rappel important : « Comme si ce prix qui distingue enfin un architecte peu médiatisé, ne pouvait être décerné qu’à des auteurs qui s’enferment dans une certaine démesure, (…) des donneurs de leçons un peu péremptoires qui semblent avoir oublié le principe essentiel de tout acte constructif (l’affirmation de l’accueil, de la protection, de l’ouverture aux possibles et à toute forme d’appropriation) pour préférer se plonger corps et âme dans les délices morbides de l’affirmation du geste même. »[v]
Cette idée que l’architecture n’existerait qu’au-delà de l’usage a déjà pu nous traverser ; au-delà de l’usage et « dans un ensemble de qualités qui en font une œuvre d’art, un objet capable, par sa force esthético-symbolique de transcender les contingences de sa destination initiale »[vi].
Un peu d’espoir : retour à l’usage
Moins d’espace, moins d’objets, moins d’images, moins de formes… moins de plaisir, moins de vie ?[vii]
Pourtant « toute culture porte le besoin dans l’accroissement »[viii] et l’on ne peut se laisser glisser dans la dépression collective, dans la nostalgie d’un âge d’or.
La question de l’usage, de ce que la forme architecturale doit ménager, représente un champ culturel suffisamment vaste et complexe pour porter en germe les possibilités de l’art et du plaisir. Il ne s’agit pas de jouer l’usage contre la forme, les deux se donnent en même temps, dans le même mouvement[ix]. Mais une focalisation sur l’usage, voire sur les formes de l’usage, peut être extrêmement fertile. A côté des revues d’architecture conventionnelles, dont seul un mauvais usage ne les considère que comme des recueils d’images, des revues comme « Le Visiteur » depuis une douzaine d’années, ou Criticat plus récemment réussissent à rendre compte de l’expérience vécue des bâtiments rencontrés, mettant parfois en avant – pour notre bonheur – la subjectivité du critique dans ses penchants les plus caustiques[x].
Les rapports qu’entretiennent l’usage et le bâti sont au cœur de l’indispensable livre de Daniel Pinson « Usage et architecture ». La problématique de l’usage y est posée à travers ces trois questions :
« . l’usage serait-il un résidu de la pensée fonctionnaliste du Mouvement Moderne, dans la mesure où l’ambition de ce dernier a été la réalisation d’un produit adapté à un certain type de consommation, voué à la reproduction simple ?
. ou bien est-ce le point d’achoppement, le récif sur lequel le Mouvement Moderne a buté, faute de prendre en compte la réelle densité du concept d’usage ? Celui-ci ne peut se réduire en effet à l’idée d’utilisation ; il recouvre une réalité anthropologique que les concepts d’us et coutumes ou de convention expriment bien mieux.
. ou bien encore est-ce un critère totalement contingent, parfaitement conjoncturel, dont la temporalité circonstancielle est passagère et ne doit en rien compromettre la trans-temporalité qui caractériserait l’œuvre d’art, à laquelle s’assimilerait l’architecture ? »[xi]
Et l’auteur poursuit « En réintégrant certaines dimensions de l’usage (l’appropriation) qui précisément tiennent à la présence active du sujet vis-à-vis de l’objet devant ou dans lequel il est, dans la durée, une esthétique existe potentiellement, qui ne réduirait pas l’architecture à l’immédiateté d’un spectacle purement visuel (dans une filiation kantienne qui doit sans doute beaucoup à la réflexion sur la peinture au XVIIIème siècle). A cette contemplation passive peut en effet se substituer un ensemble d’émotions perceptives bien plus étendues et non moins dignes de la légitimité esthétique. Certains indices, certaines recherches en montrent l’émergence »[xii]. Ces possibilités constituent une large part de notre programme.
Des formes plus simples pour des usages plus denses pourrait bien être l’un des objectifs de cette sensibilité architecturale contemporaine dont le livre « Building simply » compile des exemples. Le long article introductif de Florian Musso[xiii] pose l’ambigüité de ce retour au simple. Le débat mérite un développement spécifique qui n’a pas sa place ici.
Les fonctions les plus prosaïques de la vie humaine sont la matière même du livre de Bernard Rudofsky (architecte et commissaire – notamment – de l’extraordinaire exposition du MoMA de 1964 : Architecture without architects) « Now I lay me down to eat »[xiv]. Pointant en introduction l’impossibilité matérielle de la disposition traditionnellement représentée de la Cène, le dernier repas du Christ, puisque celui-ci et ses apôtres, compte-tenu des mœurs de l’époque, étaient allongés et non pas assis à table (d’où le titre du livre), l’auteur décrit et compare les usages des cultures occidentales et orientales, passées et présentes, incarnant les actions élémentaires de la vie humaine : manger, s’asseoir, se laver, se baigner (qui n’a rien à voir en orient avec se laver) et dormir. Très richement illustré par de véritables images d’usages, ce livre plein d’humour se parcourt dans la joie.
On peut sans doute considérer que l’habiter est le premier usage de l’architecture et si l’on reconnaît avec Bachelard que « tout espace vraiment habité porte l’essence de la notion de maison »[xv], la maison, lieu d’épanouissement des usages décrits par Rudofsky, est également le lieu de la sécurité, de la confiance qui autorise la rêverie : « La maison est une des plus grandes puissances d’intégration pour les pensées, les souvenirs et les rêves des hommes. Dans cette intégration, le liant c’est la rêverie »[xvi].
D’autres images d’usage, créations spécifiques d’architectes cette fois, mériteraient une étude plus approfondie. Ce sont tous les schémas et diagrammes utilisés par les architectes dans la présentation de leurs projets afin d’expliquer à leur commanditaire l’articulation des usages à la forme construite. Le chef d’œuvre du genre est pour moi le projet de villa au bord de la mer Una piccola casa ideale de Gio Ponti (1939)[xvii] qui associe, dans une esthétique éthérée assez éloignée de la puissance du réalisme artistique de l’époque, schéma fonctionnel, plan coloré et vues perspectives d’usages de toute beauté. L’histoire de ces représentations reste à faire et le genre connaît aujourd’hui un nouveau souffle : tous les jeunes architectes japonais accompagnent la présentation de leurs projets de diagrams à l’expression très élaborée, véritables formes d’usages parfois assez éloignées de la commande et que les maîtres d’ouvrages doivent découvrir avec étonnement[xviii].
Une autre voie d’accès à l’usage passe par la réévaluation du toucher par rapport à la vue. Ce thème est développé par l’architecte finlandais Juhanni Pallasmaa dans son livre au titre éloquent « The eyes of the skin » (je reviendrai sur ce livre et son auteur dans le paragraphe consacré aux rapports que la phénoménologie entretient avec l’architecture). Le sens du toucher étendu à l’hapticité est très bien décrit dans le très utile petit livre « Toucher, audition et odorat en architecture » : « Le sens du toucher (qui n’est pas à proprement parler un sens comme le sont les autres parce que n’étant pas supporté par un organe unique ou double) regroupe en fait quatre formes de sensibilités cutanées : celles aux pressions, celles aux pressions profondes et à la douleur, celle au froid, celle au chaud, auxquelles il faut ajouter la kinesthésie (muscles + position des articulations et rotations), la somesthésie (les maux internes, ex : la faim) et l’équilibre, le tout combiné. La dénomination de « sens » n’est donc pas appropriée, c’est en réalité un « système » et non un organe. Aussi par toucher, entendrons-nous l’expérience sensorielle globale, appelée haptique, et pas uniquement le tact »[xix]. Le philosophe américain George Santayana voyait au milieu du XXème siècle la possibilité, à travers l’attention, d’un art de vivre esthétique en « élargissant le plaisir esthétique, au-delà de la vue et de l’ouïe vers le toucher, le goût et l’odorat, s’apparentant ainsi à une conception spécifiquement orientale »[xx] , propos qu’illustrent bien des remarques de Bernard Rudofsky dans le livre cité ci-dessus.
Plus exigeant, cherchant à inventorier les possibilités du bien-être dans la trame dialectique du confort et de l’inconfort, le géographe spécialiste du Japon (et de l’habitat) Jacques Pezeu-Massabuau dans un livre au titre parodiant Tanizaki « Eloge de l’inconfort »[xxi], apporte un degré de raffinement supplémentaire à ce qui risquerait de n’être qu’une recherche hédoniste. Ne séparant pas le confort/inconfort moral de celui du corps, doutant donc du dualisme du corps et de l’esprit son approche prépare encore davantage la réflexion phénoménologique que nous aborderons pour finir. Telle l’évocation d’une vieille et peu accueillante maison du Rouergue où « chaque pièce recèle une odeur et un silence familier ; [où] il n’est pas jusqu’à cette glaciale humidité qui ne participe, sévère mais complice, à cette euphorie que je nomme mon bien-être ». L’évocation de cette vieille maison me rappelle la beauté des objets qui traversent les âges et cette phrase de Thierry Paquot dans son beau livre « Demeure terrestre »[xxii] : « L’usure est bienfaisante, elle rôde un moteur, patine un parquet, arrondit les angles ». Si je me suis risqué à avancer en évoquant Bachelard que l’habiter est le premier usage de l’architecture, cet essai de Thierry Paquot qui présente l’habiter à travers les œuvres de Heidegger, Lefèvre, Bachelard, Maldiney… est une indispensable somme d’informations et de réflexions sur le sujet.
« Et si le monde s’artialisait, s’il mutait en œuvre ? Et si la révolution artistique du siècle à venir devait passer par l’abandon progressif de la distinction entretenue en Occident entre des objets qui sont artistiques et d’autres qui ne le sont pas, entre des professionnels qui réaliseraient des œuvres et des amateurs qui ne se réaliseraient pas et qui, ce faisant, se contenteraient d’être et de regarder ? Et si on en finissait avec la dictature du faire et de l’accumulation ? Toutes sortes d’objets encombrent les chemins de la terre. L’ homo estheticus se moque des objets et des monuments. Ce qu’il veut avant tout, ce sont des sensations. Le terme esthétique vient du grec aisthêtis qui signifie la sensation. Il faut débarrasser l’horizon des objets inutiles, libérer l’esprit, émanciper le regard. Il faut accorder plus d’attention au monde qu’à ses représentations. Il fait accorder plus d’attention à l’attention elle-même. Un continent inconnu attend encore d’être découvert, un continent irréductible aux oppositions entre ce qui est lointain et ce qui est proche, entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. Pour celui qui sait regarder, il n’y a pas de différence entre la nature de ce qui est loin et la nature de ce qui lui permet d’en saisir l’essence, son regard. Pour le regardeur véritable, l’horizon est toujours à l’intérieur. Avant d’être in situ, toute œuvre, toute représentation est d’abord in visu. Il n’y a pas plus écologique. Comme le dit James Turell, « the perception is the medium » »[xxiii]. Ce texte, véritable programme phénoménologique sans jargon reprend le thème de conclusion de « Usage et architecture » de Daniel Pinson : « C’est donc toute une autre conception de l’architecture qu’il faut refonder, dans son articulation à la science (qui peut l’instruire dans ses méthodes et ses techniques) et à l’usage (qui intègre au-delà de l’utilité, les niveaux symboliques et esthétiques). L’attention (…) est une perspective qui va dans ce sens dès lors qu’elle implique la fréquentation assidue de l’objet esthétique, une découverte qui sollicite la sensibilité et l’intelligence, à la fois en attente et en recherche. Elle est dans ce sens « une contemplation active, exploratrice et en même temps interrogative et naïve, une contemplation qui par essence laisse être l’objet et se déploie dans la durée » »[xxiv].
Cette attention pour l’œuvre, loin de la surprise et du plaisir de la nouveauté mis en jeu dans la donation de l’art spectaculaire, se déploie alors pour le cadre bâti dans la durée, le quotidien, dans le monde de la vie cher à Husserl et dont Bruce Bégout a montré ce qu’il cache sous le paisible processus de familiarisation, de combat intérieur entre deux tonalités affectives fondamentales : confiance contre angoisse[xxv].
Donation, attention, monde de la vie, tonalités affectives, ces notions sont toutes issues du lexique phénoménologique. Nous tenterons de démêler dans la deuxième partie de cet article ce que la discipline phénoménologie peut apporter à l’architecture, ou, pour paraphraser Turell :« Le medium, c’est la conscience ».
Hugues Touton
23 janvier 2009
[i]George Steiner, Une certaine idée de l’Europe, Actes Sud, 2005, p.57. Je cite ici un homme de media, professeur de littérature comparée, il est vrai touche-à-tout mais pour qui ces questions ne sont évidement pas la spécialité, afin de montrer que ces idées infusent petit à petit dans la société. Ceux qui seraient intéressés par la version originale de ce courant de pensée peuvent aller visiter le site www.ladecroissance.org, portail vers un monde encore marginal, militant, aussi stimulant qu’outrancier.
[ii] Une alternative individuelle à ces grands changements collectifs annoncés se retrouve dans les initiatives suggérées par le courant de pensée d’origine québécoise dit de la Simplicité Volontaire qui met en avant la réduction réfléchie et voulue des besoins personnels et familiaux.
[iii] Bruce Bégout, Une place dans le monde, in Collectif, Arc-en Rêve, 2008, p.41
[iv] Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, Morel, 1863, p.30 cité par Daniel Pinson, Usage et architecture, p.22
[v] Richard Scoffier, Une architecture de prix, D’Architecture n°155, p.17
[vi] Daniel Pinson, Usage et architecture, L’Harmattan, 1993, p.7
[vii] La plupart desgrandes sagesses universelles ont mis au cœur de leurs doctrines le renoncement à l’aisance matérielle mais l’ascèse ne peut être que volontaire, d’initiative individuelle et ne peut donc faire partie de notre programme.
[viii] Michel Henry, La barbarie, Grasset & Fasquelle, 1987, p.179
[ix] Très infime et pourtant très significative, même si elle mérite dans ce contexte un développement substantiel, l’anecdote rapportée par Juhanni Pallasmaa dans son introduction au n°67 de GA consacré à la villa Mairea : pendant la conception de cette belle maison très teintée de japonisme, Aalto venait travailler à son agence en kimono.
[x] Difficile de ne pas évoquer l’article « Bernard Tschumi pour quoi faire ? » dans le Visiteur n°5 écrit par l’excellente Françoise Fromonot, aujourd’hui directrice de publication de la revue Criticat.
[xi] Daniel Pinson, Usage et architecture, op. cit., p.7
[xii] Daniel Pinson, Usage et architecture, op. cit., p.9
[xiii] Florian Musso, Simply good, in Building Simply, Birkhäuser Edition Detail, 2005, p.11 et suivantes
[xiv] Bernard Rudofsky, Now I lay me down to eat, Anchor Books, New York, 1980 (traduction par Adeline C. en cours)
[xv] Gaston Bachelard, Poétique de l’espace, Presses Universitaires de France, 1957, p.24
[xvi] Gaston Bachelard, op. cit., p.26
[xvii] Domus I 1928-1939, Taschen, 2006, pp.516-522
[xviii] Le n°100 de la revue GA Houses, par exemple, contient un très grand nombre de ces diagrams. Ceux de la star montante Sou Fujimoto pp.262, 264 et 266 expriment la variété et l’efficacité de ces petits dessins aux grand desseins.
[xix] Marc Crunelle, Toucher, audition et odorat en architecture, Editions Scripta, 2001, p.17
[xx] Daniel Pinson, Usage et architecture, op.cit., p.185
[xxi] Jacques Pezeu-Massabuau, Eloge de l’inconfort, Editions Parenthèses, 2004
[xxii] Thierry Paquot, Demeure terrestre, Les Editions de l’Imprimeur, 2004
[xxiii] Guy Tortosa, Pour un art in visu – manifeste (esth)éthique, in Gilles Clément, Les jardins planétaires, Jean-Michel Place, 1999
[xxiv] Daniel Pinson, op.cit. p.185 qui cite Jean Lacoste, L’Idée de beau, Bordas, 1986, pp.115-121
[xxv] Bruce Bégout, La découverte du quotidien, Allia, 2005